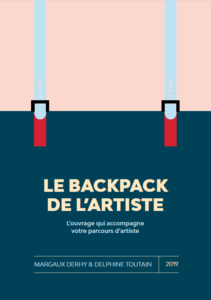Le 11 mars 1957, la France adopte une réforme majeure du droit d’auteur. Ce nouveau texte vient remplacer une série de lois éparses et parfois dépassées, dont la plus ancienne, la loi du 19 juillet 1793, avait été adoptée pendant la Révolution française. Cette loi pionnière reconnaissait des droits exclusifs aux auteurs d’écrits, de musique, de dessins ou de peintures, mais ne répondait plus aux défis posés par l’apparition de nouveaux médias comme la photographie, le cinéma ou la télévision. La réforme de 1957 est donc née d’un besoin urgent de modernisation et d’harmonisation du cadre juridique. Elle a posé les bases du droit d’auteur moderne tel qu’il est encore appliqué aujourd’hui et introduit des principes fondamentaux :
⮕ la reconnaissance de la protection automatique des œuvres dès leur création
⮕ la distinction entre droits patrimoniaux et droits moraux
⮕ l’allongement de la durée de protection patrimoniale, aujourd’hui fixée à 70 ans après la mort de l’auteur
Le droit d’auteur : que protège-t-il et quand ?
Le droit d’auteur protège les œuvres de l’esprit, c’est-à-dire les créations portant l’empreinte de la personnalité de leur auteur. Concrètement, on parle des œuvres graphiques et plastiques, des œuvres littéraires, dramatiques et chorégraphiques, des œuvres cinématographiques, musicales, des œuvres photographiques, des scénographies originales, des logiciels originaux etc.
Le droit d’auteur s’acquiert sans formalité, du fait même de la création de l’œuvre. L’œuvre de l’esprit originale est protégée à partir du jour où elle est réalisée et ce, quels qu’en soient la forme d’expression, le genre, le mérite ou la destination.
Deux piliers du droit d’auteur
Le droit d’auteur repose sur deux catégories de droits principales, complémentaires et indissociables :
🔹 Les droits patrimoniaux
Ils permettent à l’auteur de contrôler l’exploitation économique de son œuvre : reproduction, diffusion, représentation, adaptation, etc. Ces droits sont cessibles, par exemple via un contrat de cession, et ouvrent droit à rémunération. Ils expirent 70 ans après le décès de l’auteur. A partir de cette durée, on dit que l’œuvre tombe dans le domaine public. On peut alors l’utiliser sans avoir besoin de négocier de cession de droit avec l’artiste ou l’ayant-droit, à condition de respecter les droits moraux qui lui restent attachés.
🔹 Les droits moraux
Les droits moraux sont inaliénables, imprescriptibles et perpétuels. Il n’ont pas, contrairement aux droits patrimoniaux, de durée d’expiration. Ce sont des droits qui ne peuvent jamais être vendus, ni abandonnés, et ce même après la mort de l’auteur. Ils garantissent le lien entre l’auteur et son œuvre et comprennent notamment :
⮕ le droit à la paternité (être nommé comme l’auteur sur chacune de ses œuvres ou par son pseudonyme ou rester dans l’anonymat selon le choix de l’artiste si il s’oppose à ce que son nom apparaisse)
⮕ le droit au respect de l’intégrité de l’œuvre et de sa spiritualité (l’auteur peut s’opposer à toute modification, suppression ou ajout susceptible de modifier la forme ou le fond de son œuvre initiale)
⮕ le droit de retrait (l’auteur peut décider, sans avoir à se justifier, de faire cesser l’exploitation de son œuvre ou des droits cédés antérieurement à un tiers, à condition d’indemniser celui-ci pour le préjudice causé)
⮕ le droit de divulgation (l’auteur a le droit de divulguer son œuvre, de la rendre publique ou non, et peut lui seul décider du moment et des modalités entourant la première communication de son œuvre)
💰 Comment exploiter ses droits patrimoniaux ?
L’exploitation des droits patrimoniaux s’opère à travers le contrat de cession de droits d’auteur, qui peut prendre différentes formes en fonction du champ d’activité de l’artiste. Le Code de la propriété intellectuelle répertorie ainsi trois grands types de contrats de cession de droits d’auteur :
⮕Le contrat d’édition par lequel l’auteur cède à un éditeur son droit de reproduction en autorisant ce dernier à fabriquer ou faire fabriquer des exemplaires de son œuvre ou de la réaliser sous forme numérique.
⮕ Le contrat de représentation par lequel l’auteur cède son droit de représentation et autorise ainsi un tiers à représenter son œuvre dans les conditions qu’il détermine. Certains droits d’auteur ne pouvant être individuellement gérés par les auteurs, ces derniers peuvent avoir recours aux organismes de gestion collective (Sacem, Adagp, Sacd, Scam etc.) pour la gestion de leurs droits.
⮕Le contrat de production audiovisuelle qui est conclu entre un ou plusieurs coauteurs et un producteur en vue de la réalisation et l’exploitation d’une œuvre audiovisuelle (film, documentaire, reportage, etc.).
Ce que doit obligatoirement faire figurer la cession de droits :
⮕ le type de droit cédé
⮕ l’oeuvre sur laquelle la cession porte
⮕ le ou les supports concernés par la cession
⮕ la durée de la cession
⮕ la zone géographique concernée
La rémunération peut être proportionnelle aux recettes (par exemple : l’auteur va toucher un pourcentage sur les recettes de vente de son livre), forfaitaire, ou mixte.
⚠️ La différence avec le droit à l’image
Le droit d’auteur protège les créations originales de l’esprit et il confère à l’auteur des droits exclusifs sur l’utilisation et la diffusion de son œuvre.
À l’inverse, le droit à l’image concerne la protection de la personne : toute personne dispose du droit de contrôler l’utilisation de son image (photo, vidéo, etc.), même dans un espace public. Ainsi, avant de publier une photo, il faut souvent obtenir l’autorisation à la fois du photographe (au titre du droit d’auteur) et de la personne représentée (au titre du droit à l’image).
En résumé, le droit d’auteur protège le créateur, tandis que le droit à l’image protège l’individu représenté.
🧰 Faire respecter ses droits d’auteur grâce au kit de facturation Tada
Pour vous accompagner, Tada a conçu un kit de facturation pour artistes-auteurs. Il contient des modèles de cessions de droits d’auteur conforme à la législation, la liste des mentions légales à intégrer à vos factures, et tout le nécessaire pour protéger et faire respecter vos créations et votre travail, dans le cadre du droit d’auteur.
Sources
- Loi n°57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique
- Code de la propriété intellectuelle (articles L111-1 à L123-7)
- Droits d’auteur, droits voisins – Sécurité sociale des artistes-auteurs
- Droit moral, droit patrimonial – SACD